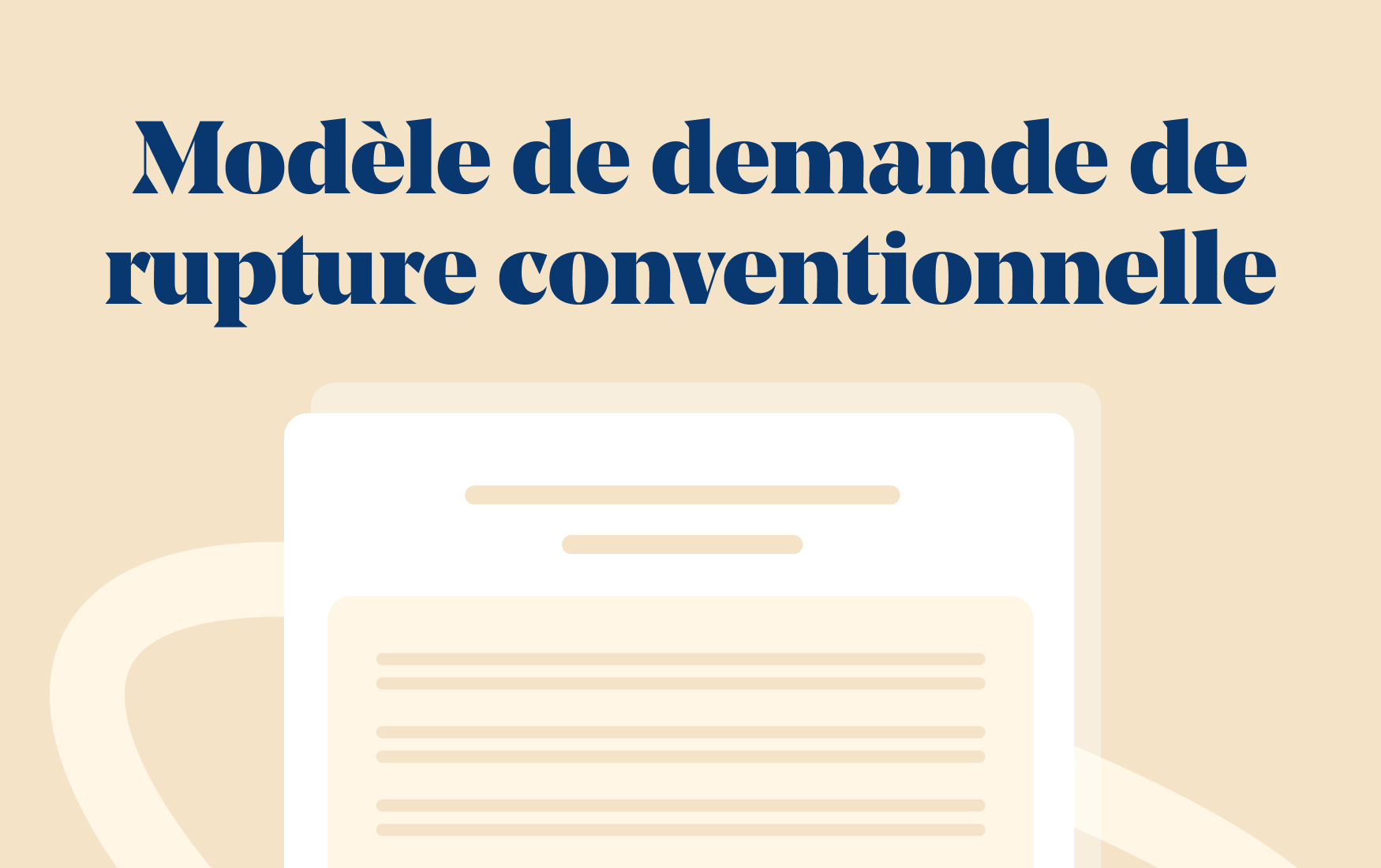Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
Comment se déroule la procédure de rupture conventionnelle ?

La rupture conventionnelle est une procédure qui permet de rompre le Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) d’un salarié. Contrairement à la démission, l’arrêt du contrat n’est pas une décision unilatérale, mais débouche d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Ce mode de rupture du contrat, encadré par les articles du Code du travail, nécessite le respect d’une procédure particulière. Le consentement des parties et l’homologation de la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) rendent la rupture légale. Pour faciliter cette démarche, le service des ressources humaines joue un rôle clé dans l'accompagnement des parties.
Quel est le modèle d’une rupture conventionnelle ? Quelles sont les étapes de la procédure de rupture conventionnelle ? Quel est le délai pour obtenir la validation de son formulaire ? PayFit vous explique.
Qu’est-ce que la procédure de rupture conventionnelle ?
La rupture conventionnelle désigne un mode de rupture à l’amiable du contrat de travail qui relève du droit commun. Ce mode de rupture du contrat de travail ne peut être envisagé que d’un accord collectif entre les parties. Autrement dit, la rupture conventionnelle ne peut ni être imposée au salarié, ni à l’employeur.
⚠️ Attention : la rupture conventionnelle se distingue des autres modes de rupture du contrat de travail, comme le licenciement économique ou la démission. Ce mode de rupture ne nécessite aucun préavis et n’est ni une décision unilatérale et imposée du salarié ni celle de l’employeur.
La rupture conventionnelle est soumise à une procédure qu’il convient de respecter, afin de garantir la liberté de consentement de chacune des parties. Aucune pression ni contrainte ne peut être tolérée, sous peine de voir la Cour de cassation annuler la convention. Ce mode de rupture du contrat de travail nécessite également de respecter strictement les délais de rupture conventionnelle, qui varient entre 40 et 45 jours. Un délai incompressible de 30 jours doit être respecté.
Tout au long de la procédure de rupture conventionnelle, le salarié continue d’exécuter son contrat de travail dans les conditions habituelles.
💡 Bon à savoir : la procédure pour une rupture conventionnelle varie légèrement en fonction de la convention collective applicable ou d'un accord collectif spécifique à l'entreprise. Les articles L1237-11 à L1237-16 et R1237-3 du Code du travail en France régulent les principes de base.
Nous pouvons citer la convention collective de l'animation, de la convention collective des prestataires de services ou du contrat de travail dans la restauration rapide. Pour tous leurs salariés, la procédure de rupture conventionnelle cumule le cadre fixé par le Code du travail avec leurs propres avantages.
Quelles sont les étapes de la procédure de rupture conventionnelle ?
Étape 1 : Demande de rupture conventionnelle
La démarche de rupture conventionnelle peut se faire à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Lorsque le salarié est à l’initiative de cette demande, ce dernier doit respecter les modalités de demande prévues par son contrat de travail.
Lorsque le contrat de travail ne prévoit rien à ce sujet, l’employeur ou le salarié envoie une lettre de rupture conventionnelle avec accusé de réception. Quel que soit votre modèle, il ne faut pas oublier d’indiquer l’article L1237-11 du Code du travail ni la date de départ souhaitée.
L'employeur et le salarié disposent chacun de la possibilité d'exprimer leur refus de procéder à une rupture conventionnelle.
Modèle de lettre de demande de rupture conventionnelle
Étape 2 : Convocation à un ou plusieurs entretiens
La procédure de rupture conventionnelle doit obligatoirement prévoir au moins un entretien de rupture conventionnelle entre le salarié et l’employeur. Ces rendez-vous sont essentiels pour décider des conditions de la rupture du contrat, c’est-à-dire :
la date de rupture du contrat de travail ;
le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle.
L’employeur qui souhaite conclure avec un salarié une rupture conventionnelle pendant son arrêt maladie doit respecter ses horaires de sortie pour rendre sa convocation légale.
💡 Bon à savoir : pour déterminer la date de rupture du contrat de travail, il faut prendre en compte le délai de la procédure de rupture conventionnelle. Cette période est communément appelée le préavis de rupture conventionnelle. Elle peut être d’environ 40 à 45 jours dans l’hypothèse où un seul entretien a été suffisant pour déterminer ces conditions.
➡️ Assistance du salarié
Lors de chaque entretien de négociation, le salarié dispose de la possibilité de se faire assister. L’assistance du salarié peut se faire par :
une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (un représentant du personnel ou tout autre salarié) ;
ou par un conseiller du salarié, choisi après consultation de l'organisation syndicale représentative.
S’il décide de se faire assister, le salarié doit informer son employeur en amont de l’entretien.
➡️ Assistance de l’employeur
L’employeur peut se faire assister uniquement lorsque le salarié en fait de même. L’assistance de l’employeur peut se faire par :
une personne appartenant au personnel de l’entreprise, disposant d'un mandat syndical ;
ou dans les entreprises de moins de 50 salariés, une personne appartenant à la même organisation syndicale ou un employeur de la même branche.
L’employeur qui souhaite se faire assister doit également informer le salarié en amont de l’entretien.
💡 Bon à savoir : dans le cadre d'une rupture conventionnelle, il est recommandé d'informer les représentants du personnel et toute organisation syndicale présente dans l'entreprise. Cette démarche n'est pas obligatoire, mais elle permet de maintenir un dialogue social constructif tout au long de la procédure.
Modèle de lettre de convocation à un entretien de rupture conventionnelle
Étape 3 : Rédaction et signature de la convention de rupture conventionnelle
Lorsque l’employeur et le salarié ont convenu d’un commun accord des conditions de rupture du contrat, ils les notifient sur une convention de rupture conventionnelle. Ce formulaire doit être daté et signé par les deux parties. Puis chacune conserve un exemplaire de la convention.
💡 Bon à savoir : le département des ressources humaines ne peut pas assister l'une ou l'autre des parties lors des entretiens de rupture conventionnelle. Il peut néanmoins apporter son expertise en amont pour expliquer la procédure, rappeler les conditions d'attribution et s'assurer que toutes les étapes seront correctement respectées. La présence des experts du département nécessite l’accord des parties.
Étape 4 : Délai de rétractation
À compter du lendemain de la signature de la convention, un délai de rétractation de 15 jours calendaires commence à courir. Durant ce délai, le salarié et l’employeur sont chacun en droit de se rétracter.
Si la fin du délai de rétractation coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite est reportée au 1er jour ouvrable suivant.
⚠️ Attention : il est important de ne pas confondre les jours calendaires avec les jours ouvrables.
Un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés non travaillés. À l'inverse, les jours calendaires incluent tous les jours du calendrier de l'année civile, y compris les jours fériés et chômés. Il est important de bien les comptabiliser pour respecter les délais de la procédure.
En cas de rétractation dans le délai, la convention de rupture doit s'annuler et le contrat de travail continue de s'exécuter normalement.
Le droit de rétractation doit obligatoirement être exercé par l’envoi d’une lettre spécifique, différente de la lettre de rupture. Pour attester sa date de réception, l’envoi d’une lettre avec accusé de réception est vivement recommandé.
Étape 5 : Demande d’homologation de la rupture conventionnelle
Au lendemain de l’expiration du délai de rétractation, la convention de rupture conventionnelle fait l’objet d’une demande d’homologation. Cette dernière est déposée auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP).
Le Cerfa de demande d’homologation de la convention de rupture conventionnelle doit être déposé en ligne sur la plateforme de téléservice TéléRC.
L’administration dispose de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande de rupture conventionnelle en ligne, pour rendre sa décision. Elle vérifie notamment les conditions d'attribution de la rupture conventionnelle avant de valider la demande. En l’absence de réponse de l’administration dans ce délai, la rupture conventionnelle est homologuée.
En cas de refus d’homologation de la convention par la DDETSPP, sa décision doit être motivée. La convention de rupture n’aura aucune validité et le contrat de travail du salarié continuera de s’appliquer dans les conditions habituelles.
⚠️ Attention : la rupture conventionnelle d'un salarié protégé fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'inspection du travail et répond à des règles particulières.
Étape 6 : Fin du contrat de travail
Si elle a respecté la procédure légale, la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée intervient à la date prévue par la convention.
Dès la fin du contrat de travail, l’employeur doit impérativement remettre au salarié les documents de fin de contrat :
le certificat de travail ;
le solde de tout compte ;
l’attestation France Travail (anciennement attestation Pôle emploi) ;
un récapitulatif de l’épargne salariale.

Qui saisir en cas de litige concernant la procédure de rupture conventionnelle ?
Tout litige sur la procédure de rupture conventionnelle doit faire l’objet d’une saisine du Conseil de prud’hommes. Le délai est de 12 mois à compter de l’homologation de la convention de rupture ou du refus d’homologation.
Envie de gagner du temps sur la paie ?

Foire Aux Questions (FAQ)
La rupture conventionnelle et la démission partagent le même objectif : rompre un CDI. Cependant, la démission est un modèle de rupture plus simple, car le salarié prend la décision seul et son effet est quasiment immédiat. Il n’a pas à se justifier auprès de son employeur. Un préavis doit être observé avec une durée variable en fonction du contrat de travail ou de la convention collective. Des exceptions sont accordées comme la grossesse ou la fin du congé maternité.
Le salarié démissionnaire touche une indemnité compensatrice de congés payés et l’épargne salariale comme pour la rupture conventionnelle. Néanmoins, il ne bénéficie pas d’autres indemnités comme l’indemnité spécifique ou l’indemnité compensatrice de préavis (sauf dispense par l’employeur pour cette dernière). De même, il ne touche pas de droit au chômage sauf en cas de circonstances atténuantes :
démission légitime ;
démission pour reconversion professionnelle ou création d’entreprise ;
démission en cours d’indemnisation par France Travail ;
réexamen du droit au chômage par l’Instance Paritaire Régionale (IPR).
💡 Bon à savoir : la démission ne concerne que les CDI, et non les CDD.
⚠️ Attention : même s’il n’a pas à justifier ses raisons, il est préférable de ne pas poser sa démission pour une motivation de nuisance envers l’entreprise. Sinon, le Conseil de prud’hommes ou la Cour de cassation peuvent considérer la rupture de contrat comme abusive. Si ce jugement est rendu, le salarié est susceptible de verser des dommages et intérêts.
Un licenciement économique est une décision unilatérale de l’employeur qui peut s'inscrire dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE). Même s’il n’a pas à se justifier auprès de son salarié, les raisons peuvent être les suivantes :
difficultés économiques ;
sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ;
cessation d’activité.
Il n’y a pas d’accord commun pour la validation du licenciement. En revanche, comme pour la rupture conventionnelle, la procédure peut être individuelle ou collective. Des critères permettent de sélectionner les salariés à licencier en priorité comme l’ancienneté, l’âge, les compétences, l’importance du poste, etc.
La procédure de licenciement partage des points communs avec celle de la rupture conventionnelle. Les deux ruptures nécessitent une convocation à un entretien préalable et l’envoi des documents à la DREETS pour leur homologation. Cependant, l’employeur consulte le Comité Économique et Social (CSE) de l’entreprise avant la tenue de l’entretien préalable au licenciement. Cette réunion est obligatoire en cas de réorganisation du personnel ou si le salarié en est un représentant. Le PSE est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés et doit obtenir l’homologation de la DREETS.
Le délai de préavis varie en fonction de la rupture conventionnelle ou du licenciement. Dans le premier cas, 30 jours s’écoulent entre la signature de la convention et l’homologation de la DREETS. Dans le deuxième cas, le salarié dispose d’un délai d’un mois si son ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans. Au-delà, il est de 2 mois. Quelques conventions collectives peuvent prévoir des délais plus favorables. D’un autre côté, le préavis ne s’applique pas en cas de :
dispense de l’employeur ;
consentement au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) ;
consentement à un congé de reclassement ou de mobilité.
Le salarié licencié perçoit une indemnité de licenciement économique dont le montant dépend de l’ancienneté. Il doit justifier de 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise pour bénéficier d’une indemnité égale au quart de son mois de salaire par année d’ancienneté (puis un tiers, au-delà).
Enfin, comme pour la rupture conventionnelle, le licenciement ouvre des droits au chômage. Alors que la rupture ne mène qu’à l’allocation de retour à l’emploi (ARE), le licenciement laisse le choix entre l’ARE et l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP). Cette seconde option est plus intéressante pour le chômage du salarié, car le montant des indemnités correspond à 75 % du Salaire Journalier de Référence (SJR).
Après le verdict du Conseil de prud’hommes, la Cour de cassation peut prononcer l’annulation d’une rupture conventionnelle pour un vice de consentement. Les raisons retenues par la cour sont les suivantes :
erreur, tromperie ou dol du salarié (dissimulation intentionnelle d’une information capitale, comme le projet de concurrence directe) ;
violence morale ou physique (harcèlement moral) ;
fraude (tromper l’autre partie sur les conséquences de la rupture).
Si le vice de consentement est du côté du salarié, la rupture du contrat est assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si le vice de consentement vient de l’employeur, la Cour de cassation considère la rupture comme une démission.
Pour aller plus loin...

Vous souhaitez formaliser une rupture conventionnelle et vous interrogez sur les indemnités de rupture ? PayFit vous apporte les détails.

La demande d'homologation de rupture conventionnelle en ligne se fait désormais obligatoirement via TéléRC. Suivez notre guide pour réussir chaque étape.

Rédigez un certificat de travail 100 % conforme au Code du travail. Voici le guide PayFit : mentions obligatoires, erreurs à éviter et modèles prêts à l'emploi.

Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) soutient les salariés licenciés économiques. Indemnités, accompagnement et avantages vs ARE, vous saurez tout.

Les experts PayFit vous expliquent la procédure d’un licenciement pour faute grave : motifs éligibles, droits du salarié, conseils pour éviter tout litige.

Fin de contrat de travail : règles de rupture en CDI ou CDD et indemnités : PayFit vous informe sur cette procédure encadrée par de nombreuses obligations.