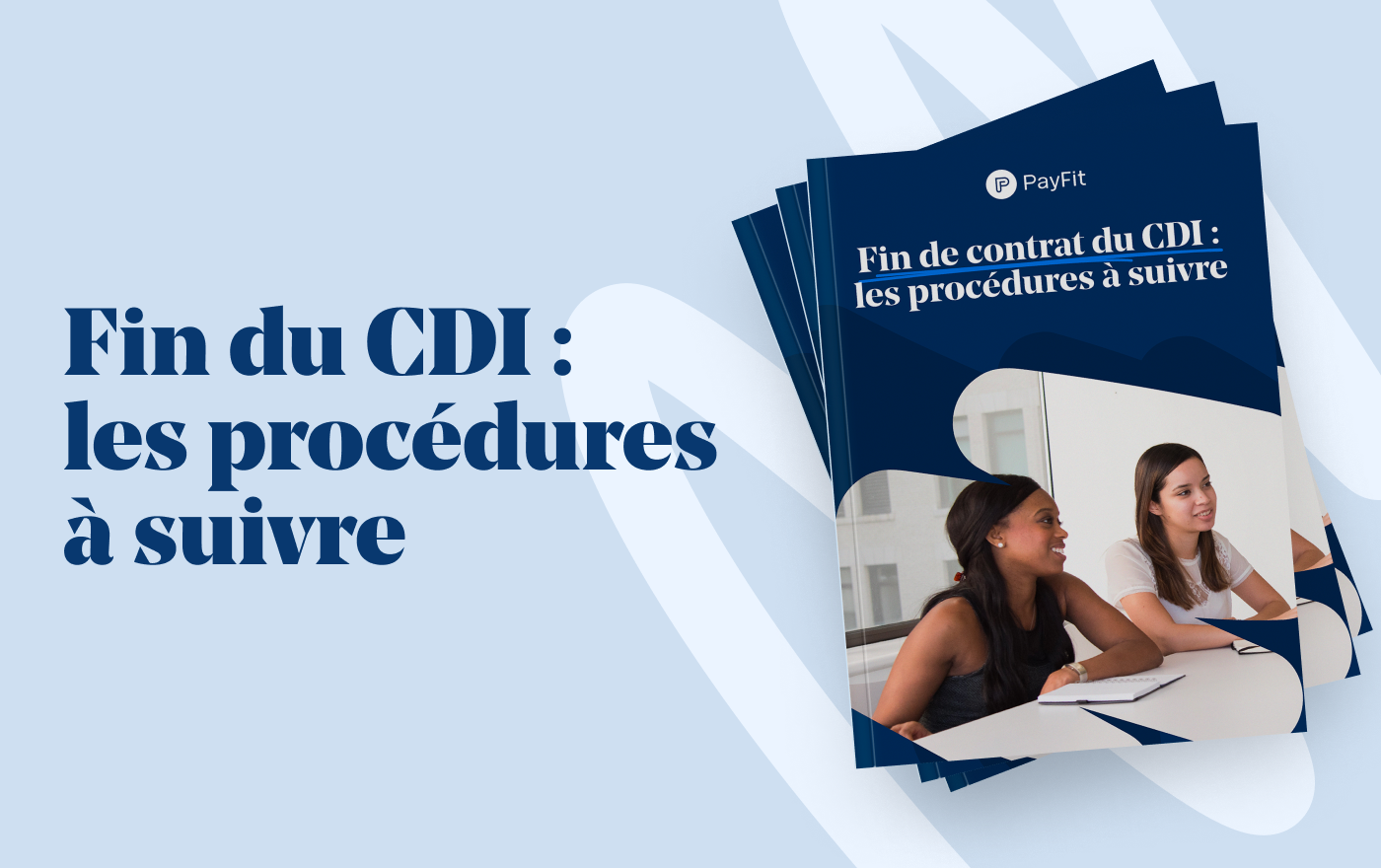Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
Comment choisir entre la rupture conventionnelle ou la démission ?

À retenir
- La rupture conventionnelle nécessite l'accord mutuel des deux parties et suit une procédure encadrée (entretiens, convention, délai de rétractation, homologation).
-
La démission est une décision unilatérale du salarié qui doit respecter un préavis, sauf dispense accordée par l'employeur.
-
La rupture conventionnelle ouvre droit à une indemnité spécifique et aux allocations chômage, contrairement à la démission qui n'offre aucune indemnité, sauf exceptions légales telles que les cas de démission légitime.
Rupture conventionnelle ou démission ? C’est la question que se posent de nombreux salariés lorsqu’ils envisagent de quitter leur emploi. Contrairement au licenciement, qui relève de la seule décision de l’employeur, ces deux modes de rupture du contrat de travail peuvent être initiés par un collaborateur pour mettre un terme à son CDI.
Mais avant de faire un choix, il convient de bien comprendre les spécificités de chaque option. Conditions, procédure, indemnités, accès aux allocations chômage : la rupture conventionnelle et la démission présentent toutes deux des avantages et des contraintes, y compris pour l’employeur.
Quelles sont les différences entre rupture conventionnelle et démission ? Quels avantages présentent-ils ? Quelles sont les procédures à suivre en cas de démission ou de rupture conventionnelle d’un salarié en CDI ? PayFit vous dresse un guide complet pour vous aider à faire le point.
Quelle est la différence entre rupture conventionnelle et démission ?
En quoi consiste la rupture conventionnelle ?
La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail qui peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Cependant, elle ne peut concerner que les salariés qui sont en Contrat à Durée Indéterminée (CDI).
D’après les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, ce dispositif doit obligatoirement reposer sur un accord commun entre un travailleur et sa direction. Elle doit respecter le consentement des deux parties et, en aucun cas, ne se voir imposer à l’une ou à l’autre. Elle doit permettre une séparation à l’amiable, née de la volonté partagée que le salarié quitte son emploi.
La rupture conventionnelle est souvent assortie d’indemnités et d’un droit aux allocations chômage.
Parfois, il arrive que l’employeur refuse la rupture conventionnelle proposée par le salarié :
soit parce qu’il ne souhaite pas se séparer du salarié ;
soit parce que la mesure apparaît trop coûteuse pour l’entreprise.
Lorsque l’employeur refuse la rupture conventionnelle au salarié, ce dernier peut alors décider de démissionner s’il souhaite quand même quitter l’entreprise.
💡 Bon à savoir : la rupture conventionnelle d’un salarié protégé répond à des règles particulières.
⚠️ Attention : même si le consentement des deux parties est avéré, la rupture conventionnelle est impossible dans certains cas fixés par le Code du travail :
si le dispositif vise à éviter un licenciement économique ;
s’il existe un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) ou un accord collectif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) ;
ou si elle intervient dans le cadre d’un accord collectif portant sur la rupture conventionnelle collective.
En quoi consiste la démission ?
À l’inverse de la rupture conventionnelle, la démission est un mode de rupture du contrat de travail à l’unique initiative du salarié. La mesure concerne exclusivement les collaborateurs en CDI.
Pour un travailleur, démissionner de son CDI met fin au contrat sans indemnité spécifique et n’ouvre pas automatiquement droit aux allocations chômage, sauf dans certains cas particuliers.
Le choix de démissionner peut survenir pour des raisons d’ordre personnel (déménagement, souhait de suivre son conjoint, etc.) ou professionnel (nouveau poste, reconversion professionnelle, mésentente avec la direction, etc.). Pour être valable, la démission doit exprimer une volonté claire et non équivoque du salarié de quitter son emploi. Contrairement à la rupture conventionnelle, l’employeur ne peut pas s’opposer à cette décision.
💡 Bon à savoir : ni la démission ni la rupture conventionnelle pour un CDD ne sont possibles. Pour rompre un contrat à durée déterminée avant son terme, le salarié ou l’employeur doit respecter l’un des motifs de rupture anticipée du CDD.
Comparatif rupture conventionnelle vs démission
Si la rupture conventionnelle et la démission poursuivent le même objectif (mettre fin à un CDI), elles sont régies par des règles différentes :
la rupture conventionnelle repose sur le consentement mutuel entre le salarié et l’employeur et est utilisée pour une séparation amiable. Elle ouvre droit à une indemnité spécifique ainsi qu’à l’accès aux allocations chômage ;
la démission reste une décision unilatérale prise par le salarié et que l’employeur ne peut contester. Elle ne donne pas droit à une indemnité de rupture ni à l’assurance chômage, sauf exception prévue par la loi.
En ce sens, ces deux modes de rupture de contrat à durée indéterminée ne suivent pas les mêmes formalités.
Guide de la gestion RH
Quelle est la procédure à suivre en cas de rupture conventionnelle ou démission ?
Procédure de rupture conventionnelle
La procédure de rupture conventionnelle pour un salarié du secteur privé en CDI suit plusieurs étapes clés :
Un ou plusieurs entretien(s) entre la direction et le salarié pour s’accorder sur les conditions de départ de l’entreprise du salarié ainsi que les modalités de l’accord (date de la fin du contrat de travail, montant de l’indemnité, préavis, etc.). Les deux parties ont le droit de se faire assister ;
La rédaction d’une convention de rupture conventionnelle qui consigne par écrit l’accord des deux parties, validé par la signature de chacune d’elles. Un exemplaire doit être remis à chaque partie ;
Un délai de rétractation : le salarié comme l’employeur ont le droit de changer d’avis. Ils disposent de 15 jours calendaires à compter du lendemain de la signature de la convention. En cas de rétractation, il est obligatoire d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception ou de la remettre en main propre contre décharge à l’autre partie ;
L’homologation de l’accord de rupture conventionnelle qui consiste à valider l’accord auprès de l’administration.
💡 Bon à savoir : d’après la loi, il n’existe pas de formalisme pour demander une rupture conventionnelle. La demande peut se faire à l’oral (entretien physique ou téléphonique) comme à l’écrit (lettre papier, mail, etc.).
Pour homologuer la rupture, la convention doit être transmise à la DDETSPP, soit par le salarié, soit l’employeur via le téléservice TéléRC, ou en remplissant le formulaire Cerfa n° 14598. Si la DDETSPP n’a pas répondu à la demande dans un délai de 15 jours, l’homologation de la convention est validée.
⚠️ Attention : dans la rédaction de la convention, les parties doivent tenir compte du délai de rupture conventionnelle. Celui-ci comprend le délai de rétractation (15 jours calendaires) et le temps nécessaire à l’homologation par l’administration (en principe 15 jours ouvrables). Il faut donc prévoir au minimum 30 jours incompressibles avant la rupture effective. En pratique, la durée totale est souvent de 40 à 50 jours. Le contrat de travail ne pouvant être rompu avant son homologation, sa date de fin doit être fixée postérieurement à celle-ci.
La procédure de rupture conventionnelle est relativement courte pour permettre à l’employeur de se séparer rapidement d’un salarié qui a la volonté de quitter l’entreprise. Il n’y a pas de préavis de rupture conventionnelle. Une fois la convention homologuée, le contrat de travail est rompu à la date prévue par l’employeur et le salarié.
Procédure de démission
La démission d’un salarié, quant à elle, ne suit pas de procédure formalisée par le Code du travail. Elle peut néanmoins être encadrée par le contrat de travail ou une convention collective.
Lorsqu’un collaborateur souhaite démissionner, il doit en avertir son employeur au préalable, à l’écrit, par lettre ou oralement.
Dans la majorité des cas, le travailleur doit respecter un préavis de démission. La durée de celui-ci est indiquée soit dans le contrat de travail du salarié, soit dans la convention collective applicable à l’entreprise, ou peut résulter d’un usage. Le délai de préavis est le même que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.
💡 Bon à savoir : l’employeur peut dispenser le salarié d’effectuer son préavis afin qu’il quitte l’entreprise immédiatement. Il est aussi possible pour le collaborateur de requérir une dispense de préavis.
⚠️ Attention : la procédure de démission peut se révéler plus longue que la rupture conventionnelle, notamment si le préavis s’étend sur plusieurs mois.
La durée de préavis varie selon les secteurs d’activité. Par exemple, dans la convention collective HCR (Hôtels, Cafés et Restaurants), elle est fixée à 15 jours pour les salariés de catégories socioprofessionnelles “employés” ayant entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté. La convention collective Syntec prévoit quant à elle un préavis de démission de 3 mois pour les ingénieurs et cadres.
Que les salariés optent pour la rupture conventionnelle ou la démission, leurs droits diffèrent concernant les indemnités, l’accès au chômage, la date de fin de contrat, ainsi que la gestion des congés payés.
Quelles sont les indemnités à verser par l’employeur lors d’une rupture conventionnelle ou une démission ?
Lors de la rupture du contrat de travail, l’employeur est tenu de verser obligatoirement certaines indemnités au salarié, qu’il s’agisse d’une démission ou d’une rupture conventionnelle.
Le montant et la nature de ces sommes dépendent de la situation du salarié pour :
l’indemnité compensatrice de congés payés si le salarié n’a pas utilisé tous ses congés payés ;
l’indemnité compensatrice de préavis si l’employeur dispense le collaborateur d’effectuer son préavis ;
l’épargne salariale, le cas échéant ;
l’indemnité de clause de non-concurrence si elle est prévue dans le contrat de travail du salarié.
D’autres indemnités supplémentaires peuvent s’ajouter selon le mode de rupture du contrat de travail.
En cas de rupture conventionnelle, le salarié doit percevoir l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui est obligatoire, et ce, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise. Le calcul de cette indemnité est encadré par des règles strictes : elle ne peut être inférieure à l’indemnité de licenciement et doit correspondre à l’accord négocié entre les deux parties figurant sur la convention de rupture conventionnelle. Si le salarié remplit les conditions, au terme de son contrat, il peut être indemnisé par France Travail et bénéficier de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE).
En cas de démission, l’employeur n’a pas à verser d’indemnité de départ au salarié. En effet, ce mode de rupture du contrat de travail n’ouvre pas droit au versement d’une somme spécifique pour le salarié. Hormis les cas particuliers, démissionner ne donne pas droit à l’allocation chômage.
Si le salarié n’est dans aucune de ces situations, l’employeur n’a l’obligation de lui verser que la dernière rémunération, et de lui fournir les documents de fin de contrat.
💡 Bon à savoir : entre rupture conventionnelle ou démission, la décision du salarié est le plus souvent motivée par l’accès au droit de chômage.
Rupture conventionnelle ou démission : en résumé
La rupture conventionnelle répond à une procédure particulière et est soumise à une volonté des deux parties, à un accord sur les modalités de départ du salarié et à une validation par l’administration (homologation de la convention de rupture conventionnelle).
Aucun préavis n’est à respecter par le salarié pour quitter l’entreprise, mais l’employeur doit lui verser une indemnité de départ (indemnité de rupture conventionnelle). La procédure est d’environ 40 à 50 jours.
La démission n’intervient que si le salarié le souhaite. Pour l’employeur, par rapport à la rupture conventionnelle, l’avantage réside dans l’absence de démarches administratives à effectuer.
Le salarié doit respecter un préavis de démission plus ou moins long en fonction du secteur d’activité et de son ancienneté. En revanche, l’employeur n’a aucune indemnité de départ à verser.
Ces deux modes de rupture du contrat de travail comportent à la fois des avantages et des inconvénients pour l’employeur comme pour le salarié. Il est donc important d’évaluer soigneusement chaque option avant de prendre une décision.
Envie de gagner du temps sur la paie ?

Foire Aux Questions (FAQ)
La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail en CDI, basé sur le consentement mutuel entre le salarié et l’employeur. Elle suit une procédure encadrée par le Code du travail (articles L1237-11 à L1237-16). La rupture conventionnelle nécessite des entretiens, la signature d’une convention, un délai de rétractation et une homologation par l’administration. Pour le salarié, elle ouvre droit à une indemnité spécifique de rupture ainsi qu’aux allocations chômage.
La démission est une décision unilatérale du salarié qui manifeste sa volonté de quitter son emploi. Elle ne nécessite pas d’accord de l’employeur. Le salarié doit respecter un préavis, sauf dispense. La démission n’ouvre pas droit à une indemnité de rupture ni aux allocations chômage, sauf exception.
La procédure de rupture conventionnelle doit débuter par un ou plusieurs entretiens entre l’employeur et le salarié afin de négocier les conditions de rupture (date, indemnités à verser, modalités). Une convention de rupture est ensuite rédigée puis signée par les deux parties. Un délai de rétractation de 15 jours calendaires est prévu. Ensuite, la convention est envoyée à l’administration pour homologation. La rupture ne prend effet qu’après validation de l’administration. Le salarié perçoit alors une indemnité de rupture spécifique et peut prétendre aux droits au chômage.
Tout dépend si l’on se place du point de vue de l’employeur ou du salarié.
Côté salarié, la rupture conventionnelle est généralement plus avantageuse, car elle donne accès à une indemnité spécifique, aux allocations chômage et à une possible négociation sur le délai du préavis, ce qui n’est pas le cas de la démission.
Côté employeur, la démission implique moins de démarches administratives, car elle ne nécessite ni indemnité ni homologation, contrairement à la rupture conventionnelle. Néanmoins, les deux parties doivent tenir compte de la durée de la procédure ainsi que du délai de préavis à respecter (ou de son coût en cas de dispense avec indemnité compensatrice).
Bien qu'en principe la démission n'ouvre pas droit aux allocations chômage, certaines démissions légitimes permettent au salarié démissionnaire d'en bénéficier :
les motifs familiaux représentent la majorité des cas reconnus : démission pour suivre son conjoint qui change de résidence pour un nouvel emploi, déménagement lié au mariage ou PACS, ou accompagnement d'un enfant handicapé admis dans une structure éloignée ;
les situations de violence ou d'impayés constituent également des motifs légitimes : non-paiement des salaires avec ordonnance de référé, actes délictueux subis au travail, ou violences conjugales nécessitant un changement de résidence. Dans tous ces cas, un dépôt de plainte est exigé ;
depuis 2019, les salariés justifiant de 1 300 jours travaillés sur 60 mois peuvent démissionner pour un projet de reconversion professionnelle ou de création d'entreprise, à condition que ce projet soit validé par l'Association Transition Pro avant la démission.
Enfin, si aucune exception ne s'applique, le salarié peut demander un réexamen de sa situation après 121 jours de chômage non indemnisé, en justifiant de ses recherches d'emploi actives.
Pour aller plus loin...

Vous souhaitez formaliser une rupture conventionnelle et vous interrogez sur les indemnités de rupture ? PayFit vous apporte les détails.

La demande d'homologation de rupture conventionnelle en ligne se fait désormais obligatoirement via TéléRC. Suivez notre guide pour réussir chaque étape.

Rédigez un certificat de travail 100 % conforme au Code du travail. Voici le guide PayFit : mentions obligatoires, erreurs à éviter et modèles prêts à l'emploi.

Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) soutient les salariés licenciés économiques. Indemnités, accompagnement et avantages vs ARE, vous saurez tout.

Les experts PayFit vous expliquent la procédure d’un licenciement pour faute grave : motifs éligibles, droits du salarié, conseils pour éviter tout litige.

Fin de contrat de travail : règles de rupture en CDI ou CDD et indemnités : PayFit vous informe sur cette procédure encadrée par de nombreuses obligations.