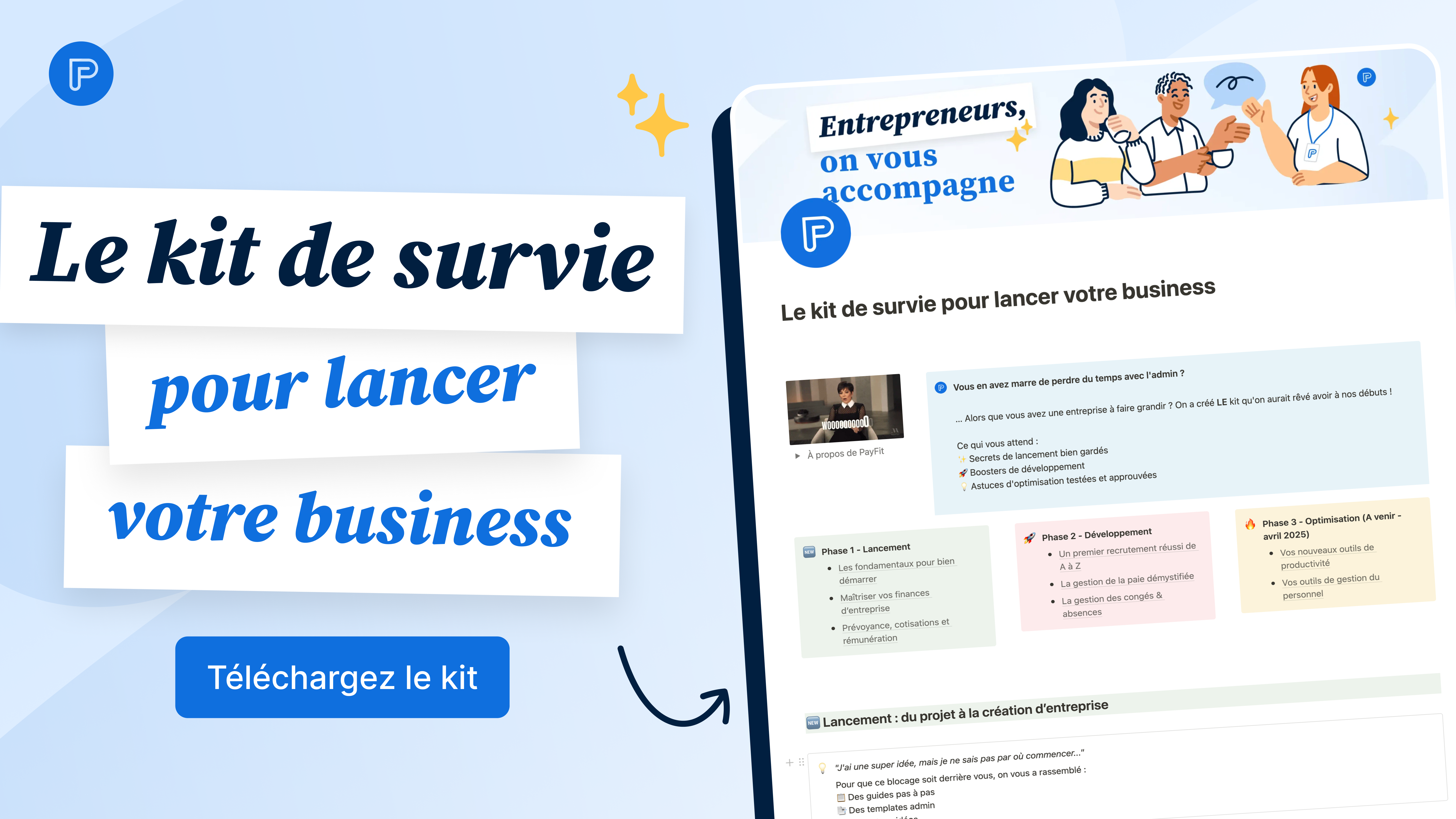Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
Quels sont les avantages et les inconvénients de l’EURL ?

Vous voulez créer votre entreprise en solo et vous hésitez sur le statut juridique ? En 2025, l'EURL reste un choix populaire pour entreprendre seul : responsabilité limitée, charges TNS réduites (environ 45 %) et flexibilité fiscale. Mais ce statut présente aussi des contraintes. Guide complet pour comprendre les avantages et inconvénients de l'EURL et faire le bon choix.
Qu’est-ce qu’une EURL ?
L’EURL, ou entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, est une structure juridique pensée pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer seuls tout en séparant leur patrimoine personnel des risques liés à l’activité professionnelle.
Elle peut être créée par une seule personne, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une société, et convient à de nombreuses activités commerciales, artisanales ou industrielles (hors certains secteurs réglementés).
Sa gestion est confiée à un gérant, obligatoirement une personne physique, qui peut être l’associé unique ou un tiers.
Quels sont les avantages d’une EURL ?
Des cotisations sociales moins élevées
Le gérant d’une EURL relève du statut de travailleur non salarié (TNS), ce qui implique des cotisations sociales moins élevées que celles appliquées aux assimilés salariés, comme le président de SASU, par exemple.
Cette différence se traduit par un coût global moins important pour l’entreprise, ce qui peut représenter un avantage non négligeable, notamment lors des premières années d’activité. Cet avantage se retrouve également dans le traitement des dividendes en EURL, où seule une partie peut être soumise aux cotisations sociales sous certaines conditions.
La protection du patrimoine de l’associé unique
L’EURL permet à l’associé unique de protéger son patrimoine personnel en limitant sa responsabilité au montant de ses apports. Cela signifie qu’en cas de difficultés financières, les dettes de l’entreprise ne peuvent être réglées que dans la limite du capital social, même s’il n’est que symbolique.
C’est un véritable atout pour entreprendre sereinement, en séparant les risques professionnels des biens personnels.
Une fiscalité flexible
L’un des atouts majeurs de l’EURL réside dans la souplesse de son régime fiscal. Par défaut, l’imposition se fait à l’impôt sur le revenu (IR).
L’EURL permet d’opter pour l’impôt sur les sociétés (IS), une alternative intéressante dans certaines situations pour mieux maîtriser la fiscalité de ses revenus.
Un capital social librement déterminé
L’EURL offre une grande liberté en matière de capital social. Aucun minimum n’est imposé par la loi : l’associé unique fixe le montant qu’il juge adapté, en fonction de l’envergure de son projet et des besoins de financement de l’entreprise.
Cette souplesse permet de lancer une activité avec un capital réduit, tout en conservant la possibilité d’augmenter le capital par la suite si nécessaire, en fonction du développement de la société ou pour renforcer sa crédibilité auprès des partenaires.
Le kit de survie pour lancer votre business
Quels sont les inconvénients d’une EURL ?
Une protection sociale moins complète pour le gérant de l’EURL
Ce régime social permet de réduire significativement les charges sociales grâce à son rattachement au régime des travailleurs non salariés (TNS). Cependant, ce statut d'EURL offre une protection sociale moins complète que celle des assimilés-salariés, notamment en matière de retraite, de prévoyance et d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail.
Un cadre juridique strict
Si l’EURL offre de nombreux atouts, son cadre juridique peut parfois représenter une contrainte selon la nature du projet.
Certaines règles doivent être respectées, notamment en matière de gouvernance, de nomination du gérant ou de gestion des parts sociales. La structure impose un certain formalisme, qui peut limiter la flexibilité dans l’organisation ou l’évolution de l’entreprise.
Ce cadre, bien que sécurisant, peut ne pas convenir à tous les profils d’entrepreneurs, en particulier ceux qui recherchent une plus grande souplesse dans la gestion.
Une image parfois perçue comme fragile
L’EURL peut parfois souffrir d’une image moins rassurante auprès de certains partenaires. Le fait qu’elle repose sur un associé unique peut donner une impression de fragilité ou de manque de solidité, en comparaison avec des structures pluripersonnelles comme la SARL.
Cette perception peut influencer la confiance des investisseurs, des banques ou même de certains clients, notamment lors des phases de démarrage ou de recherche de financement.
Un formalisme administratif à anticiper
La gestion d’une EURL implique de respecter plusieurs obligations au fil de la vie de l’entreprise : tenue d’une comptabilité, approbation annuelle des comptes, rédaction de procès-verbaux, mise à jour des statuts en cas de modification…
Ces démarches exigent du temps et parfois l’accompagnement d’un professionnel. Comparé à des régimes/statuts juridiques plus légers comme la micro-entreprise, le niveau d’exigence administrative peut freiner certains créateurs, surtout en phase de lancement.
Quelles sont les étapes pour créer une EURL ?
La création d’une EURL (forme unipersonnelle de la SARL) passe par plusieurs étapes clés à respecter :
la rédaction des statuts : ce document encadre le fonctionnement de l’entreprise. Il doit comporter certaines mentions obligatoires, comme la dénomination sociale, l’objet, le siège ou encore le montant du capital ;
le dépôt du capital social : l’associé unique effectue le dépôt des fonds (en numéraire) auprès d’une banque ou d’un notaire. Une attestation de dépôt lui est remise, nécessaire pour la suite des démarches ;
la signature des statuts : une fois le capital déposé, les statuts peuvent être signés ;
la publication de l’annonce légale : un avis de création doit être diffusé dans un journal d’annonces légales compétent dans le département du siège social ;
l’immatriculation de l’EURL : la demande se réalise en ligne, via le guichet unique des formalités des entreprises (https://procedures.inpi.fr), avec l’ensemble des pièces justificatives et le paiement à effectuer.
Une fois ces formalités accomplies, la société reçoit son extrait Kbis et peut démarrer officiellement son activité.
Choisir l’EURL ou un autre statut juridique ?
Vous souhaitez lancer votre activité sans vous associer ? D’autres formes juridiques peuvent aussi convenir aux entrepreneurs solo, à commencer par la SASU.
Contrairement à l’EURL, la SASU permet de bénéficier du statut d’assimilé salarié pour son président, avec une protection sociale plus complète, mais des charges sociales plus élevées. Elle offre également une plus grande souplesse dans la rédaction des statuts et dans la gouvernance.
Créer une micro-entreprise peut aussi séduire les entrepreneurs par sa simplicité administrative et son régime fiscal ultra-allégé. Cependant, ce statut présente des limites, notamment en matière de chiffre d’affaires : des plafonds annuels s’appliquent, au-delà desquels il est obligatoire de changer de régime.
Chaque statut présente ses propres avantages et inconvénients, à évaluer selon les priorités du porteur de projet : niveau de protection sociale, flexibilité de gestion, fiscalité, ou encore image auprès des partenaires.
💡 Bon à savoir : il est possible de transformer une EURL en SASU afin de bénéficier d’une gestion plus souple et d’une fiscalité mieux adaptée à certains projets.
Envie de gagner du temps sur la paie ?

Foire Aux Questions (FAQ)
Tout dépend de vos objectifs. L’EURL, en tant qu'entreprise à responsabilité limitée, convient aux entrepreneurs souhaitant se lancer seul tout en sécurisant leur responsabilité et en gardant une certaine maîtrise fiscale. Si vous prévoyez de vous associer à terme, une transformation en SARL est possible.
En revanche, si vous recherchez une gestion ultra-simplifiée ou une protection sociale plus étendue, d’autres statuts juridiques comme la micro-entreprise ou la SASU peuvent être envisagés. La création de votre entreprise doit également prendre en compte l'imposition souhaitée, que ce soit sous le régime de la micro-entreprise ou un autre, ainsi que le capital social minimum requis.
Le coût de création d'une EURL comprend plusieurs frais incompressibles : annonce légale (environ 120 €), frais d'immatriculation (40 €) et éventuels frais bancaires pour le dépôt du capital.
Pour une création en autonomie, comptez environ 200 €. Avec un accompagnement professionnel, le budget varie :
via une plateforme juridique en ligne : 400-600 € ;
via un expert-comptable : 800-1200 €.
💡 Bon à savoir : l'ACRE (Aide aux Créateurs et Repreneurs d'Entreprise) permet de réduire ces coûts grâce à une exonération partielle de charges sociales pendant un an.
En EURL, deux leviers principaux permettent d'optimiser sa rémunération :
le choix du régime fiscal (IR ou IS) ;
la répartition entre rémunération et dividendes.
En 2025, le statut TNS implique environ 45 % de charges sociales, contre 82 % pour un assimilé-salarié. Pour les dividendes, seuls les prélèvements sociaux (17,2 %) et le PFU (12,8 %) s'appliquent, soit un total de 30 %.
⚠️ Attention : le choix de l'IS est irrévocable. Une réflexion approfondie est nécessaire avant d'opter pour ce régime.
Pour aller plus loin...

Création SASU : maîtrisez les 5 phases essentielles pour une création réussie de votre société en 2026, du choix des statuts à l'immatriculation.

SASU et expert-comptable : tous les avantages de gérer sa comptabilité seul ou avec un professionnel. Statut, outils, coûts : PayFit vous guide.

La déclaration SCI sert à déclarer aux impôts les revenus issus des biens immobiliers. Règles, régime fiscal, choix du formulaire : Payfit vous guide.

La dissolution d'une SCI entraîne la fin de son activité. Cause automatique, volontaire ou judiciaire, procédure par étapes : PayFit vous accompagne.

Quelle est l'importance d'un expert-comptable pour votre entreprise individuelle ? Gérez votre comptabilité en toute conformité et à moindre coût.

Découvrez comment choisir l’imposition EURL la plus avantageuse, optimiser vos charges et estimer vos revenus grâce à ce guide pratique PayFit.